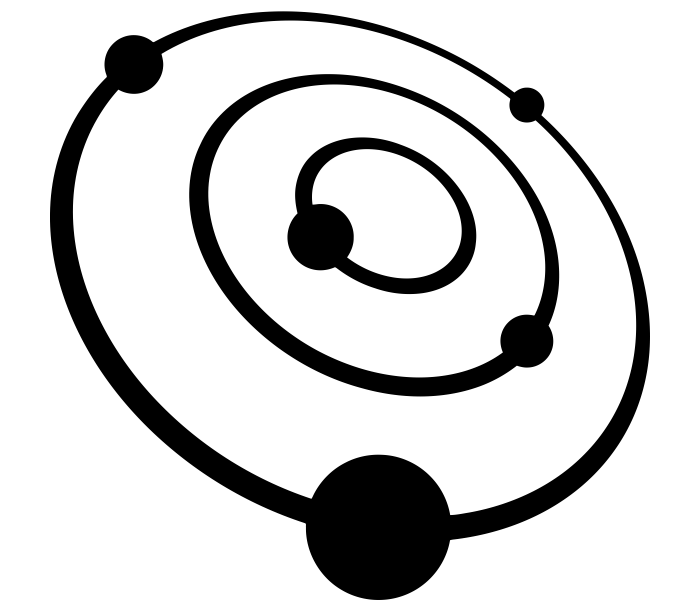« Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passionet d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. » Comme Emma Bovary, la célèbre héroïne romantique à l’idéalisme mièvre de Gustave Flaubert, nous sommes tous ou presque en quête d’un amour passionnel épanouissant. Mais ce rêve d’une vie épanouie en couple peut se transformer en cauchemar à mesure que l’on ne parvient pas à vivre ses rêves. Le bovarysme tue. À coup d’arsenic et de désillusions.
Je t’aime. Parfois si difficile à prononcer. Et pourtant si essentiel à dire. Une expression pour le moins engageante : « Il y a du contrat dans ces mots-là », comme le chantait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson « Sache que je ». Reste que ces mots paraissent bien maigres, sans épaisseur, sans variation aucune, sans nuance, en comparaison de ce que les Grecs possédaient dans leur vocabulaire. Huit manières de dire l’amour, huit façons de les distinguer, voici ce que nos ancêtres nous ont légué. Tour d’horizon de la planète amour antique.
Je t’aime. Je te désire. Éros. Ce Dieu grec primordial de l’amour et de la puissance créatrice est à l’origine de l’union sexuée entre les mâles et les femelles. On en a gardé le mot « érotisme ». C’est un amour égocentrique, par le seul fait qu’il est désir, il part de soi. Il est motivé par la beauté et la valeur de son objet. Si Éros est aujourd’hui désiré par la plupart d’entre nous, à l’époque des Grecs, ce type d’amour était parfois connoté (Dieu de la luxure, du libertinage, de l’attraction sexuelle brute, de la vulgarité du corps opposé à la suprématie de l’âme), décrié, et rares étaient ceux qui lui vouaient un culte. Selon Ines Martin : « d’un seul coup de flèche, il avait le pouvoir de former un couple de folie comme il l’a fait pour Pâris [le prince troyen], et la superbe Helen [femme de Ménélas, roi de Sparte], ce qui a finalement conduit à la guerre de Troie. Sa flèche faisait « tomber » une personne amoureuse, mais en fait, elle dérangerait son esprit et la rendait irrationnelle et dangereusement possessive et lubrique. »
Philip est le mot grec désignant l’état, le sentiment ou l’émotion de l’amitié ou de la camaraderie, l’amour que les amis se portent qui, à la différence de Éros, désigne un amour raisonnable et non passionnel. Il est à l’origine proche de la notion d’hospitalité. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote appelle philia l’affection qui fait que nous aimons un être pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il peut nous apporter.Philia peut très bien naître entre deux amants qui deviennent dès lors très complices. Comme l’écrivait Montaigne à propos de son amitié inconditionnelle envers Étienne de La Boétie : « Parce que c’était lui ; parce que c’était moi ». Cette célèbre phrase atteste du lien d’amour (Philia) indicible extrêmement fort qui peut lier deux amis.
Dire « je t’aime » à son enfant se dit Storgê durant l’Antiquité grecque. C’est l’amour familial, ou filial. Cette affection instinctive généralement mutuelle peut également désigner l’amour entre frères et sœurs ou celui qui se dessine entre un maître et son animal de compagnie. C’est un amour stable et sûr qui, généralement, dure toute une vie.
Un philanthrope sentira l’amour du prochain, un amour universel qui nous pousse à aimer autrui. Les Grecs traduisent cet amour altruiste par Agapè(qui a donné le mot « agape », signifiant une communion, un repas commun qui tire son étymologie du sens de l’affection ressentie lors de ces événements conviviaux). Les chrétiens ont traduit Agapè par le mot latin caritas, la charité, le plus haut degré d’amour inconditionnel qu’on puisse ressentir selon eux, puisqu’il est gratuit et sans motivation, universel, sans distinction aucune, englobant le genre humain, en aimant sans obtenir quelque chose en retour. C’est donc un amour désintéressé qui nous pousse à avoir de la compassion, de l’empathie ou de la pitié et nous engagerait volontiers à aider quelqu’un dans le besoin. C’est un amour qui, selon Emmanuel Carrère, « veut le bien de l’autre plutôt que le sien, l’amour affranchi de l’ego ».
Ludus (qui provient étymologiquement de « jeu »), c’est l’amour taquin, innocent, celui que nous ressentons lors des premiers moments d’une relation, un amour souvent enfantin, car naïf et ressenti tel un ras de marée lors des premiers amours. C’est une forme d’amour ludique, joueuse et parfois coquine qui s’exprime souvent dans l’affection au sein d’un jeune couple (le pouls s’accélère, on flirte, on est victime d’un état euphorique).
Pragma, ou l’amour pour la vie. Cet amour durable a mûri au fil du temps. Bien au-delà du physique, il transcende le temps et aboutit à une véritable harmonie entre deux personnes. Pragma se retrouve donc dans les couples unis depuis de nombreuses années, ou dans les amitiés qui durent. Cet amour est fait de compromis, de compréhension et de patience, afin de préserver la relation. On peut également retrouver cet amour pragmatique dans les mariages arrangés, où il s’agit de privilégier les compromis pour une cause plus grande. Pour les Grecs, Pragma était la forme la plus noble d’amour.
L’amour qui n’est pas tourné vers l’autre, mais vers soi, se nomme Philautia, amour de soi ou amour propre, dans un sens non égoïste. Si trop d’amour de soi nous ferait nous noyer dans les eaux vaniteuses de l’étang de Narcisse, avoir une bonne dose de Philautia est nécessaire pour pouvoir aimer autrui, comme le pensait le philosophe Aristote. Il s’agit d’être bienveillant envers soi-même, d’avoir de la compassion envers soi, d’avoir le souci de son propre bonheur.
Mania, ou l’amour obsessionnel (la manie, étymologiquement amour « fou »), est un type d’amour qui entraîne quelqu’un dans un type de folie. Dans cet amour, on veut aimer et être aimé, pour se sentir valorisé. Mania entraîne donc jalousie et possessivité, un déséquilibre néfaste dans un couple, car l’un des deux partenaires a désespérément besoin de l’autre. Impossible de vivre sans l’autre, cet amour fusionnel nous rappelle l’histoire déviante de Tristan et Iseut dans laquelle les amants maudits, codépendants, littéralement junkies de la passion, finiront par en mourir.
Pour finir, ajoutons le concept de l’amour platonique (qui tire son origine étymologique du célèbre philosophe antique Platon, théorie émanant du Banquet). Cette notion d’un amour chaste, vécu en dehors de toute sensualité et sexualité, un amour intellectuel entre deux êtres, date de la Renaissance (du philosophe humaniste Marcile Ficin au XVIe siècle). Il passe parfois pour le plus poétique et le plus puissant des amours, s’opposant à l’amour vulgaire qui unit deux personnes pour les biens de la reproduction. Ce qu’on aime platoniquement, ce serait l’âme de l’autre, son esprit, et non son corps. On peut inclure dans ce type d’amour les relations vécues exclusivement à distance.
Aimer à la grecque, c’est donc aimer tout en nuances. Et vous, vous aimez comment ?
Pour aller plus loin:
Luc Ferry, Apprendre à vivre, tome 2, La sagesse des mythes.