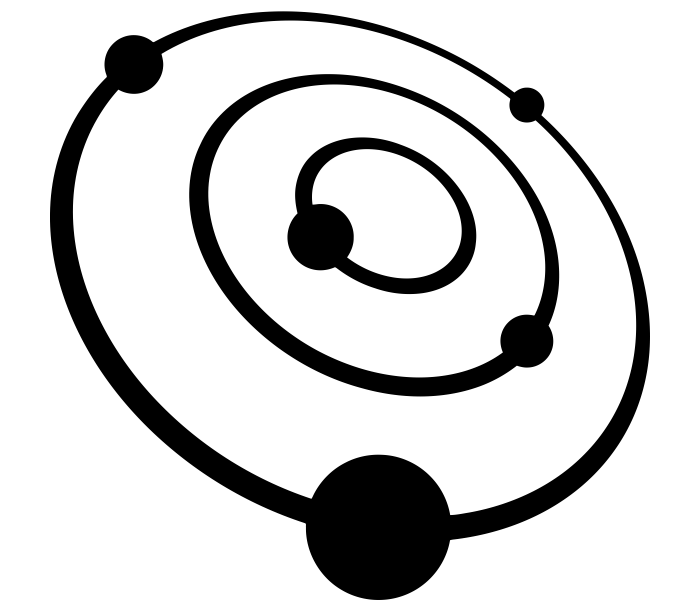par Yannick Burri | Oct 20, 2020 | blog
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: «Gardez-vous d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ». Dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau nous mettait déjà en garde en 1754 contre les dangers de la propriété, ce pouvoir de fait sur un bien.
Ceci est à moi. Ma voiture, ma maison, mon téléphone, mon chien, ma femme ou mon mari, mon amant ou ma maîtresse. Cette énumération de possessifs volontairement hyperbolique a pour vertu de nous rappeler que rien ne nous appartient jamais vraiment et qu’il y a une prétention égoïste de l’homme à vouloir s’approprier des biens ou des personnes.
L’être humain semble profondément égoïste. Derrière le capitalisme se niche l’ego et le besoin de pouvoir et de propriété, foncière ou monétaire. Même le communisme s’est engouffré dans le travers de l’égoïsme lorsqu’un Staline a voulu tout régenter et se hisser plus haut que la communauté pourtant théoriquement constitée de gens existant tous sur un même pied d’égalité.
Dans Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement, l’anarchiste français Pierre-Joseph Proudhon déclarait avec force en 1840 que « la propriété, c’est le vol ! » Car la propriété est un vol à la communauté qui est censée être égalitaire. Qui n’a jamais rêvé par envie ou jalousie d’obtenir ce qu’autrui possède ? Tout mettre à plat et ne plus rien posséder, telle serait la solution. Une énorme mise en commun égalitaire. La fin du règne du « ceci est à moi ».
Le mouvement philosophique anarchiste a, depuis le XIXe siècle, et jusqu’à aujourd’hui, tenté de se battre contre la toute puissance de l’état providence. Étymologiquement, an- signifie « sans » et arkhê « pouvoir ». L’anarchiste est celui qui s’imagine une société sans principe de commandement où les hommes seraient libres de toute contrainte autoritaire et capables de développer une société sans domination et exploitation : être solidaires, complémentaires et collectivistes.
L’idée fait rêver. Et si tout le monde ou presque semble se tourner vers plus de redistribution des richesses (quand on sait qu’un pourcent de la population possède 90 pourcents environ des biens…), le problème des anarchistes reste la capacité à s’organiser sans pouvoir étatique. Car tout un chacun n’est pas nécessairement libertaire au sens où l’entendrait son voisin.
D’autre part, nous pouvons nous rappeler que le modèle de la « commune », dans un fédéralisme total, était aussi une quête ultime. Ce n’est pas un hasard si certains anarchistes se sont implantés dans le Jura français. Cette doctrine est aussi une tentative de maîtriser le destin collectif par la décentralisation du pouvoir. Dès lors, la Suisse peut être considérée comme l’aboutissement de l’anarchisme, à travers son fédéralisme…
Mais rassurons-nous, si la Terre ne nous appartient pas et que toute propriété est éphémère à l’échelle de l’univers, notre voiture, notre maison, notre téléphone, notre chien, notre mari ou notre maîtresse ont encore de bons jours devant eux…
Pour aller plus loin :
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1754
Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement, 1840
France culture : la naissance du mouvement anarchiste
Entretien avec Eric Lordon
par Yannick Burri | Oct 13, 2020 | blog
Et si devions revivre notre vie éternellement, dans un tourbillon sans fin, sans que le moindre détail n’en soit changé ? C’est en 1881, non loin de Sils-Maria dans les Grisons, que le grand Friedrich Nietzsche eut sa révélation de l’éternel retour du même(die ewige Wiederkehr des Gleichen), une notion centrale de son œuvre qui la traverse de part en part : « Tout est déjà revenu : Sirius et cette araignée et tes pensées à cette heure, et cette pensée qui est la tienne, celle que toute chose revient », écrit-il dans La volonté de puissance, aphorisme 328.
Très éloignée de toute idée de réincarnation, dans le Gai Savoir au fragment 341, Nietzsche imagine un démon qui se glisserait chez nous et nous dirait : « Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l’as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en elle, si ce n’est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement et tout ce qu’il y a d’indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession (…) – Ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te parlerait de la sorte ? Ou bien te serait-il arrivé de vivre un instant formidable où tu aurais pu lui répondre : tu es un dieu, et jamais je n’entendis choses plus divines ! » Si cette pensée s’emparait de toi, elle te métamorphoserait, faisant de toi tel que tu es, un autre être, et peut-être t’écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose : « Voudrais-tu de ceci encore une fois et d’innombrables fois ? » pèserait comme le poids le plus lourd sur ton action ! Ou combien ne te faudrait-il pas témoigner de bienveillance envers toi-même et la vie pour ne désirer plus rien que cette dernière éternelle confirmation, cette dernière éternelle sanction ? »
Pour Nietsche, qui philosophe au marteau, celui qui serait capable d’assumer cette pensée du poids le plus lourd deviendrait le « surhomme » (der Übermensch), celui qui dirait un grand oui à la vie pensée comme volonté de puissance. Mais pour tout un chacun, cette idée est une immense chance de repenser sa vie. Car comme le dit l’écrivain Fred Pellerin, il existe quatre questions que l’on devrait se poser tous les jours : quel est ton rêve ? C’est pour quand ? Qu’est-ce qu’on a fait pour lui aujourd’hui (perd-on son temps ?) ? Et en quoi notre rêve est-il aussi bon pour autrui (afin que ceux-ci ne soient pas trop égoïstes) ?
En somme, il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Et si la vie devait revenir telle que nous la vivons et ce éternellement, si nous sommes d’accord de répondre un grand oui à l’éternel retour de toute chose, un immense « je le veux », c’est que nous avons fait de notre vie un rêve, une œuvre qui vaut la peine d’être vécue. Si nous répondons « non », c’est qu’il est temps de changer de vie et de se rappeler, pour citer Ionesco, que l’ « on vient au monde tous les matins ». Alors n’attendons pas demain…
Pour aller plus loin :
Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882
Les nouveaux chemins de la connaissance
Luc Ferry
par Yannick Burri | Oct 6, 2020 | blog
On pense souvent qu’improviser ne s’improvise pas. Pourtant les grands créateurs, musiciens, peintres, sculpteurs, n’ont eu de cesse de réinventer les codes de l’art, faisant entrer cette discipline dans une histoire. On peut à cet égard oser dire qu’il existe deux façons d’envisager l’art musical et que ces deux manières s’excluent mutuellement. À l’image de notre rapport au monde. L’une est héritée de l’aristocratie et de la bourgeoisie. La musique serait affaire de travail et, à force de gammes et d’abnégation, le pianiste ou le flûtiste maitriserait son art. Il passe par la théorie de la musique qu’il mettra en pratique. Il saura l’écrire, apprendra ses gammes et le solfège. L’approche classique nécessite une tenue. De la régularité dans les apprentissages, du travail. Et de la raison. Au sens de René Descartes. Une méthode rationnelle.
À contrario, on trouve les adeptes de la musique jazz, incluant le blues qui en est l’alpha, trouvant son origine dans les champs de cotons et résonnant aux chants des souffrances. Ici, l’art est issu du bas peuple. Ici, la musique se transmet dans les gênes. Elle s’improvise et ne s’écrit pas. Elle est aveugle, comme Ray Charles qui apprit le piano sans avoir besoin de ses yeux, réinventant ainsi l’approche de cet instrument passant d’abord par le toucher et le rythme. Quelques accords suffisent au blues, et les notes virevoltent sur l’instrument qui improvise en jazz jusqu’à faire crier le saxophone cherchant les limites de l’instrument sans qu’aucune partition puisse rendre compte d’un tel effet sonore. Le jazz met en avant l’improvisation, le dépassement de l’instrument. Il n’est pas associé au travail ni à la raison, il est d’abord libération.
En littérature, deux mondes s’opposent aussi. La fin de la bourgeoisie s’écrit avec Marcel Proust qui passera sa vie entière à rechercher son temps perdu et le retrouver au moment de sa mort. Une vie consacrée à l’écriture. Sa recherche. À l’opposé, Sur la Route de Jack Kerouac a été écrit sur un rouleau de 120 pieds de longs telle une immense improvisation. Proust raturait et recommençait. Ses manuscrit sont parfois illisibles. Le pape de la Beat Generation se lançait à corps perdu dans une écriture sans anicroche telle une presse bien rôdée.
Nous pouvons également nous inspirer des églises. Negro spirituals, chants et sentiment de liberté contre austérité des cultes et chants catholiques ou protestants classiques. Afrique contre Occident. À nous d’adapter notre vie selon qu’on veut la vivre de façon classique, faite de labeur et de contraintes, ou selon un schéma plus jazzy, libre et émancipé. À chacun de choisir son camp.
par Yannick Burri | Sep 29, 2020 | blog
Clytemnestre, celle qui est célèbre pour ses complots, est la femme d’Agamemnon, roi de Mycènes. Elle a déjà tué son précédent mari Tantale, ainsi que leur enfant. Elle donne naissance à quatre marmots : Iphigénie, Chrysothémis, Électre et Oreste. Incapables de pouvoir partir à la guerre de Troie à cause de vents contraires lancés par Artémis, Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie sur l’autel d’Artémis. Par vengeance, le roi sera tué par sa femme en guise de vengeance à son retour de Troie. Oreste a vingt ans et reçoit un oracle : venger la mort de son père. Électre l’ambrée va aider son frère à assassiner leur mère, Clytemnestre.
C’est à partir de cette histoire mythologique que Carl Gustav Jung a théorisé le complexe d’Électre, équivalent pour les filles du complexe d’Œdipe freudien que Sigmund Freud lui-même a repris et critiqué. Vers 4-5 ans, le petit d’homme entre en concurrence avec son père ayant pour objet de désir sa mère, ayant peur de la castration (absence de pénis observée chez la mère ou la fille). Cette peur de la castration met fin au complexe d’Œdipe, ce qui amènera le garçon à être attiré par les filles à l’adolescence et conditionnera son rejet pour les hommes et fera naître en lui son hétérosexualité. Pour le dire autrement, l’homosexualité masculine serait selon Freud conditionnée par un Œdipe mal négocié.
Pour les petites filles, il en va bien autrement. En effet, selon Jean Laplance, « l’absence de pénis est ressentie comme un préjudice subi qu’elle cherche à nier, compenser ou réparer ». Aussi la demoiselle est-elle frustrée de ne pas en avoir ! La petite fille aimerait donc son père, ce héros, que pour lui soutirer son pénis en comblant un manque anatomique fondamental… Dans cette quête pour obtenir ce Graal, la mère fait office de rivale. Ce n’est qu’à l’adolescence qu’une femme sublimerait son désir de pénis ressenti durant l’enfance, trouvant un partenaire sexuel. Mais, même à l’âge adulte, selon Freud, la femme ne résoudrait jamais totalement son complexe d’Électre, sa condition étant liée à un manque, et expliquerait pourquoi les femmes seraient moins stables que les hommes sur le plan psyschique, hystériques ou caractérielles. Durant son développement, la fille grandissant continuerait de s’identifier à sa mère, même si elle est considérée comme une rivale. Ce qui expliquerait les rapports particuliers et complices qu’entretiennent souvent une mère et sa fille.
Evidemment, il faut considérer que les filles ont une connaissance de l’anatomie masculine suffisamment riche à cet âge pour que la théorie tienne. Combien de jeunes filles voient leur père ou un homme nu ? Difficile de désirer un pénis quand on n’en a jamais vu… Bien évidemment, les féministes de tous horizons détestent cette théorie, puisque les filles seraient des hommes avec un objet en moins, le pénis, manque qu’elles désireraient combler, des garçons privés de pénis en somme, dans une négativité jugée outrancière. Autre conséquence, le complexe d’Électre n’étant jamais vraiement résolu, l’homosexualité féminine s’expliquerait plus facilement. Autrement dit, même la psychanalyse est sexiste.
Pour aller plus loin:
Christian Godin et Gilles-Olivier Silvagny, La psychanalyse pour les nuls, First, 2012.
Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontais, Vocabulaire de la psychanalyse, 1967, Éd.: Quadrige/PUF, 2007.
Je t’aime etc
par Yannick Burri | Sep 22, 2020 | blog
Il était une fois la légende la plus célèbre de l’Antiquité. Un jeune garçon du nom d’Œdipe, nom signifiant « pieds enflés » (lui qui avait été attaché par les pieds pour être tué), fils de Laïos et de Jocaste, fut exposé dès sa naissance à une prophétie confiée à son père. Le garçon serait parricide et matricide. Ses parents décidèrent de le sacrifier, mais le petit d’homme en réchappa et fut recueilli par ceux qu’il croyait être ses vrais parents, Polybe et Méropé, à Corinthe.
Un beau jour, sachant sans doute que quelque chose ne tournait pas rond, il décida d’aller voir la Pythie de Delphes qui lui révéla son oracle : il tuerait son père et marierait sa mère. Sous le choc, le futur prince décida de s’en aller et, en tentant d’échapper à son destin, il réalisa la prophétie, et s’engouffra tout droit dans la gueule du loup. Arrivé devant Thèbes, son véritable père lui barra la route et son « hybris » légendaire, sa démesure, conduisit Œdipe à le tuer. Puis il délivra les Thébains de la Sphinge, animal monstrueux qui mangeait les habitants, en répondant à la fameuse énigme : « Sur terre il est un être à deux, quatre, trois pieds, et même voix toujours (…) Quand, pour hâter sa marche, il a le plus de pieds, c’est alors que son corps avance le moins vite. » C’est de l’homme qu’il s’agit ! Car il commence à marcher à quatre pattes, puis à deux, pour finir par se tenir sur un bâton. Libéré de la Sphinge, Œdipe est accueilli en héros et se verra offrir Jocaste, sa véritable mère désormais veuve, en guise d’épouse, et lui fera quatre enfants incestueux.
À la fin du XIXe siècle, un Viennois patriarcal du nom de Sigmund Freud utilisa ce mythe pour en faire un concept central de la théorie psychanalytique : la première topique. Le complexe d’Œdipe concerne tous les jeunes enfants âgés de 4 à 7 ans environ et désigne le désir inconscient d’entretenir un rapport sexuel avec le sexe opposé, une relation incestueuse. Œdipe pour les garçons s’est ensuite transformé en Électre chez les filles. Si une jeune fille aime son papa, elle voudra dormir avec, elle lui fera plein de bisous, lui dira « je t’aime » bien souvent et fera de sa mère une rivale à évincer du lit conjugual. Idem pour le petit bout d’homme…
Comment lutter, à supposer que cette théorie soit universelle, ce qui est très contestable ? Aux parents de mettre des barrières, rappeler aux petits Œdipe qu’ils peuvent aimer, mais que l’amour a ses degrés et ses limites à ne pas franchir. Ne pas céder et faire dormir les petits dans leurs lits quand on le peut. Ne pas briser les couples. Car les complexes sont tenaces et si l’Œdipe n’est pas résolu, disait Freud, il surgira dans le futur de l’adulte bon nombre de frustrations et de névroses. Les enfants doivent transférer leur amour pour leur parent à quelqu’un d’autre dès l’adolescence. C’est à ce prix qu’on évite bon nombre de séances onéreuses chez le psy…
Pour aller plus loin :
Sophocle, Œdipe Roi, le livre de Poche, LGF, 1994
Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, Payot, 2001
Christian Godin et Gilles-Olivier Silvagny, La psychanalyse pour les nuls, First, 2012.
Emission de France Culture
Micro-philo
par Yannick Burri | Juin 22, 2020 | blog
Sommes-nous seuls dans l’univers, ce monde infini, en constante expansion, composé de milliards d’étoiles et de planètes ? La probabilité est bien mince. Toutefois, il est fort peu probable que nous tombions un jour nez à nez avec un extraterrestre. Et si ça arrivait ? Seraient-ils gentils ou méchants ? La question que soulève le film Premier Contact, de Denis Villeneuve, est sans doute la plus pertinente : comment pourrions-nous le savoir, si nous ne pouvons communiquer avec eux? Ces œufs immenses qui colonisent plusieurs endroits du globe habités par des créatures étranges qui communiquent par des dessins fabuleux derrière une vitre tels d’immenses calmars venus d’ailleurs mettent à rude épreuve les meilleurs linguistes de la planète.
Le contact avec l’autre en tant que tout autre a toujours fasciné les hommes depuis qu’ils ont conscience de n’être qu’un grain de sable dans l’univers. Voltaire imaginait déjà un géant de 32 km de haut arriver sur notre petite planète bleue depuis Sirius. Les hommes, tels des Lilliputiens, se voyaient offrir une leçon de vie puisqu’avant de repartir, ce microméga offrait un cadeau aux humains : celui d’un livre contenant les secrets de la vie et de l’univers. Et à ces derniers de l’ouvrir et de constater que les pages sont vierges, que tout est à écrire. Ou qu’il n’y a rien à dire… Plus récemment, E.T., le célèbre long métrage de Steven Spielberg, a fait rêver tant d’enfants, en racontant la rencontre du troisième type avec un petit être dont un jeune garçon se prend d’affection et qui cherche désespérément, à coups de « téléphone maison », à retrouver les siens, sans aucune intention malveillante. C’est l’homme qui maltraite ce petit bout d’alien. Comme dans King Kong, la bête, c’est l’homme et la ville, c’est la jungle.
Plus intéressant encore, le film d’animation Planète 51, de Jorge Blanco, tend un miroir déformant aux êtres humains dans un genre de Lettres persanes peuplée de petits hommes verts ressemblant à s’y méprendre aux habitants de la Terre renverse la donne. L’extraterrestre, c’est lui !
Henri Bergson propose une expérience de pensée inédite (Les Deux Sources de la morale et de la religion) : si les hommes se reconnaissent et s’assemblent, c’est qu’ils se posent en s’opposant. Je suis moi car je ne suis pas toi. D’une famille naît un village. D’un village un canton. D’un canton une nation, puis un continent. Mais les continents ne se réuniront jamais dans les projets de paix perpétuelle kantienne, si l’on en croit Henri Bergson, car ils existent en s’opposant, dans leur complémentarité et leurs différences. Un américain n’est pas européen. D’ailleurs, l’Europe a été unifiée pour s’opposer aux grandes puissances mondiales comme les Etats-Unis.
Mais si les extraterrestres débarquaient sur terre, parions que Bergson aurait tort, que nous n’aurions d’autre choix que de nous réunir dans un élan planétaire.
Alors, à quand notre rencontre avec les aliens ?
Pour aller plus loin :
Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, GF, Flammarion, 2012.
Thibaut Gress et Paul Mirault, La philosophie au risque de l’intelligence extraterrestre, Vrin, 2016.
Voltaire, Micromégas, 1752.